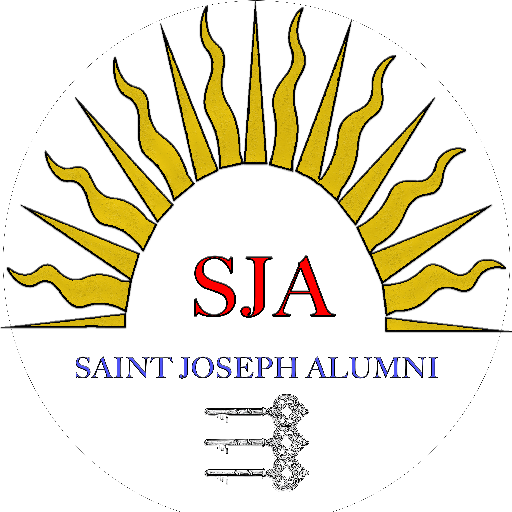1850–1939 : Du renouveau républicain aux bouleversements du XXe siècle
Après plusieurs décennies de fermeture et de tâtonnements, le lycée d’Avignon est officiellement ouvert au public en janvier 1850. Installé dans les bâtiments réaménagés de l’ancien couvent des Cordeliers, ce nouvel établissement prend place dans un contexte national tendu entre héritage religieux et aspirations républicaines. L’anecdote qui entoure ses premiers mois d’existence témoigne d’ailleurs de ces tensions : à l’époque, la loi Falloux — votée le 15 mars 1850 mais pas encore appliquée — n’a pas encore officiellement renforcé l’influence de l’Église dans l’enseignement. Pourtant, dans l’attente de cette mise en œuvre, les inspections académiques au sein du lycée se heurtaient à une situation inhabituelle. En effet, pour ne pas compromettre l’image laïque du jeune établissement, certains pères de famille remplaçaient discrètement les pères jésuites durant les visites de l’inspection. Ce subterfuge témoigne du jeu d’équilibre délicat entre pouvoir religieux et exigences étatiques dans la fondation d’un enseignement secondaire stable à Avignon.
Au fil des années, le lycée s’inscrit durablement dans le paysage urbain et intellectuel de la ville. Des travaux d’aménagement sont réalisés pour adapter les anciens espaces conventuels à leur nouvelle fonction pédagogique : salles de cours, dortoirs, réfectoires, laboratoires ou encore bibliothèques voient progressivement le jour. Le lycée devient un lieu de discipline rigoureuse, fidèle au modèle républicain : les élèves, en grande majorité issus de la bourgeoisie locale, suivent un enseignement structuré autour des humanités classiques, du latin, des mathématiques et de l’histoire. L’uniforme est de rigueur, l’internat souvent obligatoire, et les examens rythment la vie scolaire.
L’avènement de la Troisième République (1870) marque un tournant décisif dans la politique éducative française. Les lois scolaires de Jules Ferry, en 1881–1882, instaurent l’enseignement gratuit, laïque et obligatoire. Le lycée devient alors un pilier de l’idéal républicain, un lieu de formation des futurs citoyens, et un bastion de la culture nationale. Le personnel enseignant se compose souvent de figures engagées dans les combats politiques et intellectuels du temps, défenseurs acharnés de la laïcité, parfois anticléricaux. La pédagogie s’ouvre lentement à de nouvelles disciplines : sciences expérimentales, langues vivantes, géographie, et progressivement, les portes du lycée s’ouvrent à une population plus diversifiée.
Durant la Première Guerre mondiale (1914–1918), le lycée, comme partout en France, est profondément marqué par le conflit. De nombreux anciens élèves sont mobilisés et tombent au front. Une plaque commémorative est plus tard installée dans l’enceinte de l’établissement pour honorer leur mémoire. Malgré les difficultés, les cours continuent. Certains bâtiments sont réquisitionnés à des fins militaires, parfois pour accueillir un hôpital temporaire.
L’entre-deux-guerres (1919–1939) est une période de reconstruction et de modernisation. Le lycée s’adapte à l’évolution des méthodes pédagogiques, au développement des sciences et aux attentes nouvelles d’une société marquée par l’essor industriel et les mouvements sociaux. Il devient aussi un lieu de mémoire, où les cérémonies du 11 novembre et les commémorations de guerre jouent un rôle important dans la formation morale des élèves. Des discussions apparaissent sur l’ouverture de l’enseignement aux jeunes filles, bien que les lycées féminins restent souvent séparés.
À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, le lycée d’Avignon s’est définitivement imposé comme un acteur central de la vie intellectuelle et républicaine de la ville, témoin et acteur des grands bouleversements de son temps.